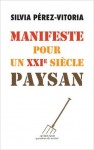Pour s’alimenter en produits animaux, l’homme s’est longtemps contenté de ponctions effectuées sur des bêtes mortes – mortes naturellement, tuées par d’autres prédateurs ou chassées. Ce n’est qu’après la domestication – un processus à l’origine non destinée à l’alimentation – que les humains ont pu augmenter leurs prélèvements sur les animaux, se contentant non plus seulement des chairs, des organes et des graisses, mais mangeant également les produits fournis par les bêtes vivantes comme le lait, les œufs ou, dans de rares cas, le sang. Ces nourritures animales, auxquelles on peut ajouter le miel, pouvaient alors être produites de façon plus régulière, plus contrôlée. Hautement périssables, elles ont connu au cours de l’Histoire de multiples transformations destinées à leur conservation (salage, fumage, dessiccation, fermentation, etc.).
Pour s’alimenter en produits animaux, l’homme s’est longtemps contenté de ponctions effectuées sur des bêtes mortes – mortes naturellement, tuées par d’autres prédateurs ou chassées. Ce n’est qu’après la domestication – un processus à l’origine non destinée à l’alimentation – que les humains ont pu augmenter leurs prélèvements sur les animaux, se contentant non plus seulement des chairs, des organes et des graisses, mais mangeant également les produits fournis par les bêtes vivantes comme le lait, les œufs ou, dans de rares cas, le sang. Ces nourritures animales, auxquelles on peut ajouter le miel, pouvaient alors être produites de façon plus régulière, plus contrôlée. Hautement périssables, elles ont connu au cours de l’Histoire de multiples transformations destinées à leur conservation (salage, fumage, dessiccation, fermentation, etc.).
Parmi l’ensemble des aliments, les produits animaux sont certainement ceux dont l’ingestion connaît le plus grand nombre de règles – que ces règles soient des prescriptions et proscriptions verbalisées ou qu’elles relèvent d’une simple conformité à des usages. Ainsi, les tabous portant sur les viandes sont pléthores : insectes et animaux de compagnie en Occident, volaille, œufs et poisson dans certaines régions d’Afrique, etc. On peut également tracer une géographie de l’abstention de lait en Asie de l’Est et du Sud-Est. De nombreuses prescriptions concernent par ailleurs les modes d’obtention et de transformation (règles concernant l’abattage, découpes spécifiques, cuissons séparées) et la consommation (périodes d’abstinence, quantités limitées) de ces aliments. De façon symétrique et inverse, ces nombreuses restrictions vont de pair avec une très grande valorisation de certaines nourritures animales dans de nombreuses sociétés : lait en Asie du Sud, bœuf aux Amériques, mouton en péninsule arabique, etc. Le statut cérémoniel de ces aliments tient à l’importance symbolique conférée à certains animaux, à l’allure collective que peut prend leur abattage et leur partage ainsi qu’au coût d’obtention de ces produits.
Actuellement, on assiste à une hausse mondiale de la consommation de produits animaux, du fait notamment de l’intensification des méthodes d’élevage, de l’extension spatiale des circuits d’approvisionnement et d’une hausse du pouvoir d’achat. Pourtant, cette « transition alimentaire » doit être considérée avec une grande prudence, tant de nombreux contre-modèles résistent ou émergent : politisation du végétarisme en Inde, baisse de la consommation de viande rouge en Occident, en lien avec des préoccupations environnementales et sanitaires, voire militantisme animaliste appelant à une alimentation vegan. Les initiatives menées par la bio-ingénierie se multiplient aujourd’hui pour tenter de produire ces aliments sans avoir recours aux animaux : viande in vivo, lait de synthèse, etc., ce qui pose de sérieuses questions quant à nos modes de relation avec les bêtes et aux risques liées à l’industrialisation croissante des processus de production.