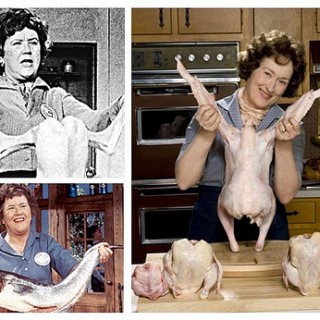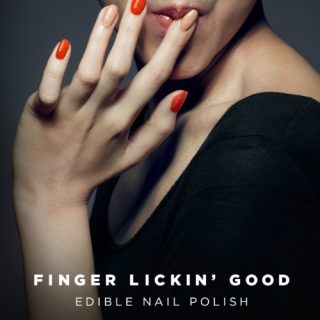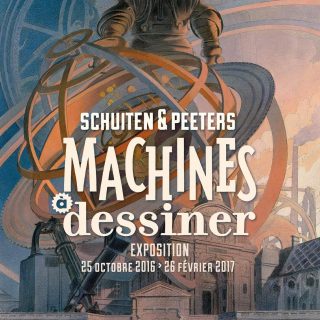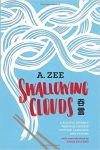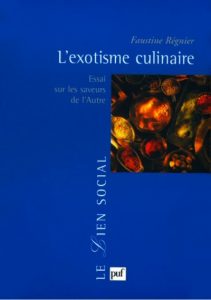 Fondé sur l’exploitation de 10000 recettes de la presse féminine publiées entre les années 1930 et 2000, cet ouvrage se consacre à ce qu’on appelle les « saveurs de l’Autre ». Quelle est l’histoire de l’exotisme culinaire ? Comment ingère-t-on des cuisines étrangères ? Comment pense-t-on l’Autre à travers sa cuisine ? Telles sont les questions abordées par ces pages qui s’adressent à un vaste lectorat : il y trouvera l’analyse précise de nombreuses données, ainsi que l’apport méthodologique et théorique susceptible d’expliquer une forme singulière de perception sociale de l’altérité.
Fondé sur l’exploitation de 10000 recettes de la presse féminine publiées entre les années 1930 et 2000, cet ouvrage se consacre à ce qu’on appelle les « saveurs de l’Autre ». Quelle est l’histoire de l’exotisme culinaire ? Comment ingère-t-on des cuisines étrangères ? Comment pense-t-on l’Autre à travers sa cuisine ? Telles sont les questions abordées par ces pages qui s’adressent à un vaste lectorat : il y trouvera l’analyse précise de nombreuses données, ainsi que l’apport méthodologique et théorique susceptible d’expliquer une forme singulière de perception sociale de l’altérité.
L’exotisme culinaire nourrit des liens avec l’histoire de la gastronomie et avec les pratiques de contact avec l’étranger (colonisation, immigration, tourisme) : il relève ainsi du fait social. La question fondamentale concerne cet Autre que l’on dit « exotique ». Codification et valeur positive de l’altérité, l’exotisme culinaire met en scène un Autre à la fois proche et lointain, semblable et différent. L’appropriation sociale de l’altérité se révèle tout à la fois une réduction et une reconnaissance de la différence.
Faustine Régnier, docteur en sociologie de l’institut d’études politiques de Paris, est chargée de recherche au Laboratoire de recherche sur la consommation (Corela) à l’INRA et enseigne à Sciences-Po Paris. Elle est lauréate du Prix Jean Trémolières.